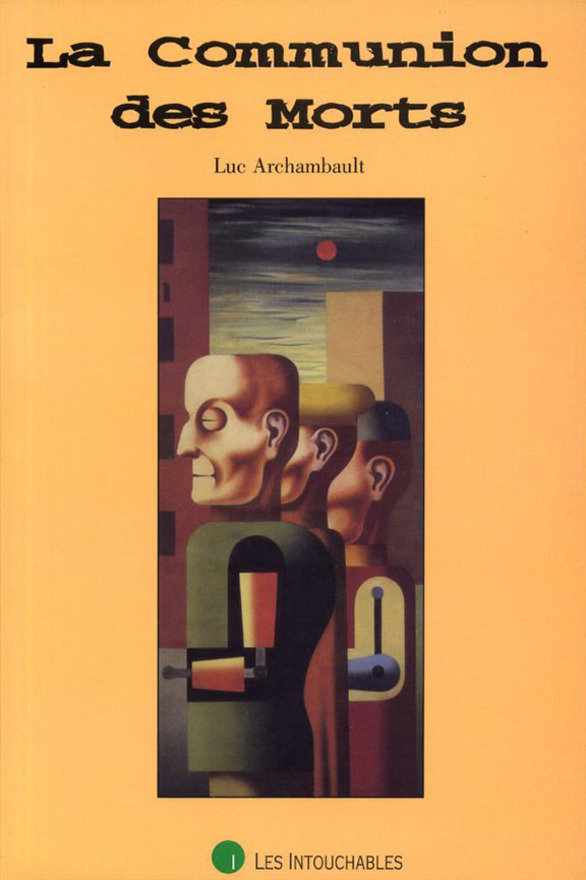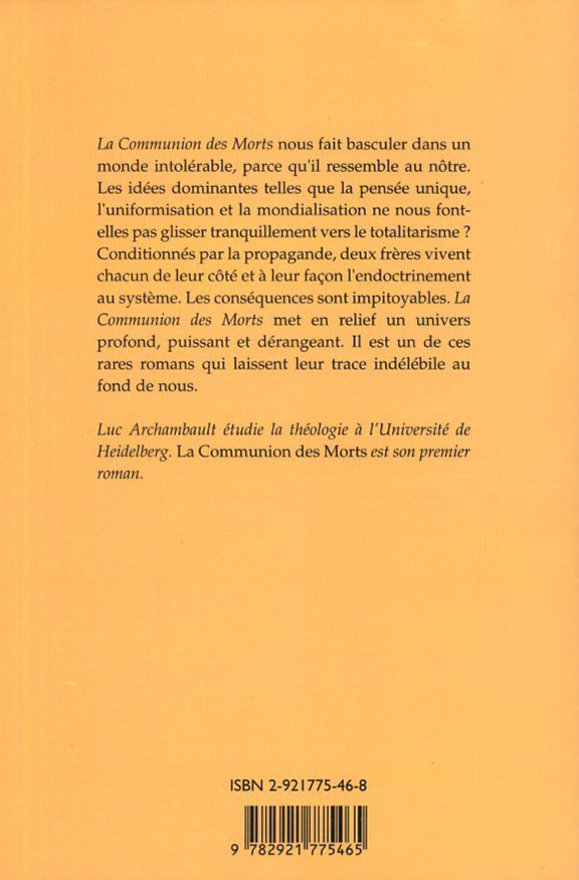À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
Jean et Pierre sont les fils du très redouté ministre de l’Intérieur, dans une société totalitaire du futur en guerre depuis des décennies. Cette guerre en est une de défense des nantis contre les hordes affamées survivant sur la planète en déliquescence. Jean, à l’origine médecin, est entré dans le système et passe avec succès son examen d’élève-officier, qui consiste à torturer à mort un de ses condisciples. Pierre, grâce aux moyens pécuniaires de sa mère membre de l’ancienne aristocratie, vit encore en marge. Il rencontre ainsi Marie-Hélène, architecte et artiste qui veut encore croire à la Beauté dans ce monde de Laideur. Elle emménage avec lui en profitant de son indifférence affective. En réalité, Pierre veut s’engager dans l’armée et se battre aux premiers rangs, ce qu’il finit par obtenir malgré sa mère et au grand plaisir de son père. Celui-ci dénonce d’ailleurs sa femme comme ennemie du régime : cette société repose sur la délation et l’élimination (« désinfection ») systématique des opposants. En réalité, il s’agit, d’une part, de liquider les représentants de l’ordre ancien et, d’autre part, d’éliminer tout simplement un maximum de bouches en prévision de la reconstruction future.
C’est à un camp de « désinfection » que Jean est affecté ; des trains arrivent de partout, on trie, une partie des prisonniers va directement aux chambres à gaz, l’autre rejoint les travailleurs aidant à l’effort de guerre. Jean est très troublé de constater que l’orthodoxie des dirigeants des camps laisse beaucoup à désirer. Après avoir touché le fond, il amorce une trajectoire de purification personnelle sur le plan idéologique, mais aussi sur le plan spirituel. Il finit par se faire transférer de façon frauduleuse au front, comme soldat-médecin, et y accomplit de nombreux hauts faits.
Pendant ce temps, Pierre, farouche guerrier, se retrouve vite dans une « unité noire », les élites combattantes. Sa mystique du combat se développe et s’épure. Lors d’une action d’éclat derrière les lignes ennemies, il est blessé et devient inapte au service actif. Il est renvoyé à l’arrière où il retrouve Marie-Hélène, épousée avant son départ, toujours amoureuse, aux lettres de laquelle il n’a jamais répondu, et qui essaie désespérément d’être enceinte de lui. N’y parvenant pas, elle est contrainte à devenir mère porteuse pour servir le Régime. Désespérée, elle finit par se pendre.
Le père de Pierre et de Jean se meurt d’un cancer. Après une campagne d’épuration plus radicale que les autres et annonçant le Grand Bond en Avant menant à la Reconstruction Finale, il reprend contact avec Pierre et lui fait comprendre la noble justesse de son projet et de leur sacrifice à tous. Pierre est transféré à l’Office d’action théologique et, dans une grande discussion finale, il convainc Jean de se joindre à lui pour sauver l’Humanité.
Commentaires
L’auteur, je veux le préciser tout de suite, étudie la théologie à l’Université de Heidelberg, et c’est son premier roman. L’écriture en est lourdement compétente, en accord avec la substance dont elle ne vient jamais distraire, la fictionalisation étant, ma foi, utilitaire et minimale. On voit en alternance le point de vue de Jean, de Pierre et de Marie-Hélène (qui a droit à des paragraphes sans majuscules : une façon de signifier la désorganisation de sa féminité, en sus du contenu sentimental et larmoyant de ses interventions ?). Les partage-t-on ? La narration choisie (en JE dans les trois cas) nous invite, nous pousse à nous identifier tour à tour à chacun de ces personnages. Mais en ce qui me concerne, l’identification a été impossible, dans un premier temps parce qu’il m’était difficile d’établir ce à quoi on voulait me forcer à m’identifier (et donc, corrélativement, à m’opposer) et qu’ensuite, ce que j’ai cru comprendre m’a causé un malaise profond.
A priori, je suis plutôt pour les livres qui dérangent, surtout quand ils prétendent être de la science-fiction. Mais il y a malaise et malaise. Le « bon malaise » vous sort de votre boîte, vous fait voir le monde, la société et l’être humain dans une lumière nouvelle, libératrice. Le « mauvais malaise » est de l’ordre de la fange : il vous englue dans des idées aliénantes empaquetées de façon faussement nouvelle, manipule vos émotions en vous entortillant dans des rationalisations mensongères, vous tire vers le bas et vous emprisonne. Enfin (car il n’y a jamais rien d’aussi simple qu’une opposition terme à terme), il y a le malaise intermédiaire : lorsqu’on ne sait pas trop à quel malaise on a affaire !
La Communion des morts nous fait basculer dans un monde intolérable, parce qu’il ressemble au nôtre, affirme la quatrième de couverture, pour continuer, de façon assez simplistement réductrice : « Les idées dominantes telles que la pensée unique [sic], l’uniformisation et la mondialisation ne nous font-elles pas glisser tranquillement vers le totalitarisme ? » Mais en fait, pour qui a lu son Dostoïevski, ce roman tout entier est une glose – ou pis : une nouvelle mouture romancée – du discours du grand Inquisiteur dans Les Frères Karamazov (1880). Résumons celui-ci de façon quelque peu terroriste : les humains sont des moutons stupides qui ont besoin d’un Bon Pasteur plus intelligent qu’eux et autodésigné, lequel en tue certains pour le plus grand bien du troupeau et prend sur lui, noble et émouvant sacrifice, les souffrances morales et spirituelles qui s’ensuivent. On put voir par la suite, avec la révolution bolchevique puis les divers fascismes, en commençant par leurs versions staliniste et nazie, à quoi peut aboutir ce genre d’idéologie.
Les philosophes de la première moitié du xxe siècle, aussi bien religieux que laïques, d’Henri de Lubac à Camus, ont longuement réfléchi sur les apories éthiques d’un monde où Dieu est mort (et l’on suppose que l’auteur, étudiant donc en théologie, est en plein dedans…). Il suffit de lire le long essai de Camus, L’Homme révolté, pour comprendre – et clairement alors – la nature du problème, ses tenants, ses aboutissants, et les actions possibles pour les humains de bonne volonté – et qui n’ont rien à voir avec un darwinisme primaire, l’accent y étant au contraire mis sur la solidarité en l’absence de mensonge. Les penseurs européens des années 50, à partir d’expériences collectives toutes fraîches, se posaient avec urgence un problème qui en était bel et bien un de société, et qui s’est aggravé depuis. Des raisons supplémentaires d’angoisse et de questionnement s’y sont greffées à partir des années 60, avec la montée en force (dans l’imaginaire collectif, s’entend, au niveau fantasmatique), des sciences et des technologies, et la prise de conscience planétaire dans l’écologisme. Les lecteurs de science-fiction savent à quel point ces motifs ont sollicité les auteurs depuis plus de trente ans, souvent sous la forme du futur-catastrophe et des mesures à prendre, soit pour y échapper, soit pour y survivre. De ce point de vue, La Communion des morts s’inscrit dans une longue tradition, que le roman ne renouvelle nullement, au contraire, se situant bien en deçà – en tant que fiction – de la majorité des romans de SF des vingt dernières années. La fiction, en fait, y est surtout un prétexte à exposition théorique, chacun des personnages étant une marionnette portant tel ou tel aspect de la thèse. Il n’y en a, en effet, pas deux en opposition, mais des variantes, contrairement à ce que le texte essaie parfois de nous faire croire.
Les ressources de la science-fiction elle-même sont à peine utilisées : aucune spéculation dans ce domaine. Sauf la mention des mères porteuses, la société et les technologies décrites renvoient de toute évidence à la première moitié du siècle (avec, bien sûr, l’arrière-pensée de lecture assez accablante : on les trouve encore dans la seconde moitié du siècle, et aujourd’hui…). Mais ce n’est sans doute pas ce que l’auteur veut transmettre. Ce sont les idées, la philosophie sous-jacente à ces exterminations, les guerrières et les autres, qui l’intéressent (et l’on peut constater au passage l’ennui profond qui se dégagerait de la science-fiction quand elle est seulement une « littérature d’idées » !).
Parlons-en donc, de ces idées. Et de la structure narrative qui les porte, tout de même. Lorsque j’aborde ce genre de récit, en ayant donc lu beaucoup, j’ai un certain nombre d’attentes : il existe un certain nombre, limité, de développements possibles à la situation de départ. Au moins ce roman évite-t-il le cliché ordinaire : « On se révolte contre le monde inique et on en renverse l’ordre totalitaire ». Pas ici. On rejoint, on ressource, on justifie et on parfait l’ordre totalitaire du monde inique. Comme dans 1984 dira-t-on alors, c’est plutôt bien, non ? Eh bien… pas vraiment. Le mouvement de 1984 est clair, la « thèse », le « message » : le monde de Big Brother est inique, les personnages y succombent, et le texte nous invite très clairement à nous identifier à eux, et non à Big Brother. Si l’on veut poursuivre la comparaison, La Communion des morts nous invite… à rejoindre justement les « morts », non seulement à aimer Big Brother, mais à devenir Big Brother – ou le Grand Inquisiteur – en toute clarté de conscience, en ayant eu un choix.
On argumentera sur le degré de choix des deux “héros” ; ils sont tous les deux conditionnés, certes ; la quatrième de couverture le souligne, mais oublie une nuance importante : membres de la classe dirigeante, ils ont malgré tout accès aux deux faces de la médaille : Jean dans le camp de désinfection, Pierre au front. Marie-Hélène, brebis désignée au départ, est présentée comme totalement victime de ses illusions lorsqu’elle se révolte au nom de l’Art et de la Beauté contre la laideur ambiante. Et si les expériences « transformatrices » de Pierre et de Jean sont simplement un effet plus profond de leur conditionnement, une ironie encore plus terriblement cruelle que celle de 1984, le texte ne les présente pas ainsi, mais comme de véritables épiphanies révélant une Vérité : nulle ironie orwellienne ici pour le lecteur. En fait, là où Orwell faisait truquer le jeu par Big Brother avec l’invention d’une guerre interminable justifiant les mesures d’urgence et le Maintien de l’Ordre à tout prix, dans La Communion des morts, le péril est réel, et je m’avancerai presque à dire “pour l’auteur” : la catastrophe (supposée écologique : famines…) et la lutte à mort des nantis contre les dépossédés sont un choix diégétique de l’auteur, qui nous invite alors à y voir malgré tout une justification des choix des personnages.
C’est une des forces de la SF de donner, en les incarnant, une véritable urgence aux débats autrement plutôt académiques sur la-fin-et-les-moyens, quand la Survie de l’Humanité est en jeu. Un simple petit guide de questions peut aider à la lecture de ce genre de texte, cependant : Quelle « humanité », c’est-à-dire quels groupes sont désignés pour représenter celle-ci ? Qui ou quel(s) groupe(s) se désigne(nt) comme “sauveur” ? Quels sont les moyens choisis ? Qui survit à la fin et dans quel état ? Ici, tous les personnages appartiennent au groupe des nantis ; la première victime qu’on rencontre (le condisciple de Jean, lors de la séance de torture ouvrant le récit) vient d’une classe subalterne, tout comme l’autre victime personnalisée, Marie-Hélène. Ce sont des Blancs (et peut-être des Nord-Américains). Ce sont des hommes : il y a deux autres femmes, et toutes les deux sont « désinfectées » à la suite de la décision de leurs maris : la mère de Jean et de Pierre, représentante de l’ancienne classe dirigeante « impure », et la mère de Marie-Hélène dont « l’impureté » consiste à être simplement une femme, et une mère qui refuse la mort de ses fils soldats.
La fin recherchée… eh bien, il y a en a plusieurs variantes : je dois laisser ici parler le texte. Voici d’abord ce que dit le père mourant à Pierre : « […] convergence idéologique […] notre ennemi du sud s’allie maintenant à nous, implante ses propres camps. […] Un jour, nous unifierons toute la planète. Et lorsque ce noble objectif sera atteint, la reconstruction pourra s’amorcer. La Terre reverdira. Les ressources humaines seront strictement contrôlées afin d’éviter tout épanchement néfaste à sa survie. Les erreurs du passé ne se répéteront pas puisque nous les avons comprises. Le règne de l’Homme nouveau pourra commencer, et enfin ce sera la fin de l’histoire après des siècles d’anarchie. […] Tu peux briguer les plus hauts postes. Car tes actes parlent pour toi […] un leader respecté et craint, généreux et austère. » Sur ce, le futur Petit Père du Peuple euthanasie son prédécesseur, à la demande de celui-ci.
Réflexions de Pierre après la mort de ce père qu’il « maudit et abhorre » : « Je dois à mon tour me montrer inflexible vis-à-vis de mes ouailles […] en ce monde infernal, nous devons pousser le nihilisme du passé à son extrême limite afin de le consumer, peut-être au prix de notre vie. […] Étant donné la gravité de la situation, est-il plus normal de refuser de se soumettre ou bien d’assumer sa place dans la hiérarchie […] sans y trouver joie ni récompense. Il faudra que la postérité puisse comprendre pourquoi nous n’avons pu éviter la barbarie. Que les victimes sacrificielles soient commémorées par les survivants. La Vérité doit triompher. L’Amour doit triompher. »
Jean lui aussi est entre temps devenu un adepte du tough love, dont le médiateur idéal est pour lui (comme pour Pierre) le Soldat : « La différence entre le camp de désinfection et le front est profonde. Au camp, la mort est virtuelle […] bureaucratique. […] au front, chaque soldat se voit investi de la médiation entre les ténèbres et la lumière. C’est en lui que s’accomplit le Destin des individus et des collectivités. Une mission providentielle où chaque geste, en soi insignifiant, atteint au sublime. » Un commentaire que n’auraient pas désavoué les unités de choc des SS, ne puis-je m’empêcher de remarquer ici.
Et il poursuit : « […] accepter l’inhumain, l’Innommable, afin de l’éteindre un jour. […] adhérer à cet Abject par amour et non seulement par devoir. »
Pierre estime que « la Culture est en lutte perpétuelle avec la Nature. Peut-être […] nos efforts se montreront-ils vains. […] au moins nos derniers instants auront été consacrés au Sacré, à l’Absolu. […] Mais je reste persuadé […] que nous méritons de survivre. »
À quoi Jean réplique (semblant contredire ses déclarations des pages précédentes) : « Tu parles de Culture en invoquant l’Absolu. […] Sais-tu seulement à quoi donne lieu ta vision sublime ? Va sélectionner pendant quelque temps. » Jean, défenseur de la Nature ? Mais quelle Nature ? (Ce n’est jamais évoqué avant ni après ; on peut cependant se rappeler tous les beaux grands Aryens blonds et bronzés qui envahissaient les plages européennes dans les années 30…). Ou n’est-ce pas plutôt pour établir une opposition – toute artificielle, donc – entre les deux frères ? Car Pierre invite Jean à le rejoindre pour « trouver un sens qui assurera le Salut à l’ensemble de l’humanité » et Jean ne refuse pas.
Pierre se lance ensuite dans le grand discours final, où l’idéologie sous-jacente s’est dévoilée plus clairement pour moi : « Il faut ériger le bûcher sur lequel nous sacrifierons de fond en comble le présent, et des cendres naîtra le futur. Qu’importe les victimes, qu’importe l’holocauste, la Terreur, pour qu’advienne la paix. […] Je te parle de Libération, Jean, de Libération. »
Et Jean de conclure (on a aussi commencé avec lui et ses doutes) : « L’Humanité est moribonde depuis longtemps. Il lui faut expier ses crimes. C’est à cette condition qu’elle pourra triompher. Nous ne pouvons plus reculer. Je ne peux plus reculer. Quitte à perdre définitivement mon âme. »
Cette ultime phrase suffit-elle à dédouaner le reste des idées exprimées dans cet ouvrage – l’habituelle fulmination utopique de la table rase dans le feu et le sang, l’apparente défense et apologie de ceux qui sont prêts (qui le leur a demandé ?) à faire le Noble Sacrifice de sacrifier les autres, le subtexte récurrent de Gotterdammerung en parallèle avec la Race Supérieure et l’Homme nouveau ? À mon avis, non. C’est encore la mauvaise foi profonde du Grand Inquisiteur, dont le but inavoué est de survivre à ses victimes en satisfaisant son appétit de pouvoir.
Je me suis demandé, en refermant ce livre, s’il serait publié en Europe. Certainement pas en Allemagne, où l’on n’aurait aucun mal à reconnaître de quoi il s’agit malgré le déguisement de la SF et la fausse urgence du Futur Catastrophe et de la lutte à mort des nantis et des autres (considéré comme un donné, choix biaisé au départ, donc). Indépendamment des convictions réelles de l’auteur – je n’ai que le texte, n’évalue que le texte par rapport à lui-même et à la culture qui lui donne naissance – je me suis pourtant demandé, en refermant ce livre, s’il a été publié ici à cause d’une naïveté politique de l’éditeur, à cause d’un désir irresponsable de provocation de sa part, ou parce qu’il adhère à l’idéologie présentée. Questions inconfortables. Ce livre est “dérangeant”, certes, comme s’en vante la quatrième de couverture. Mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. [ÉV]
- Source : L'ASFFQ 1998, Alire, p. 8-13.
Références
- Chartrand, Robert, Le Devoir, 07/08-08-1999, p. D3.
- Martel, Réginald, La Presse, 07-02-1999, p. B 5.