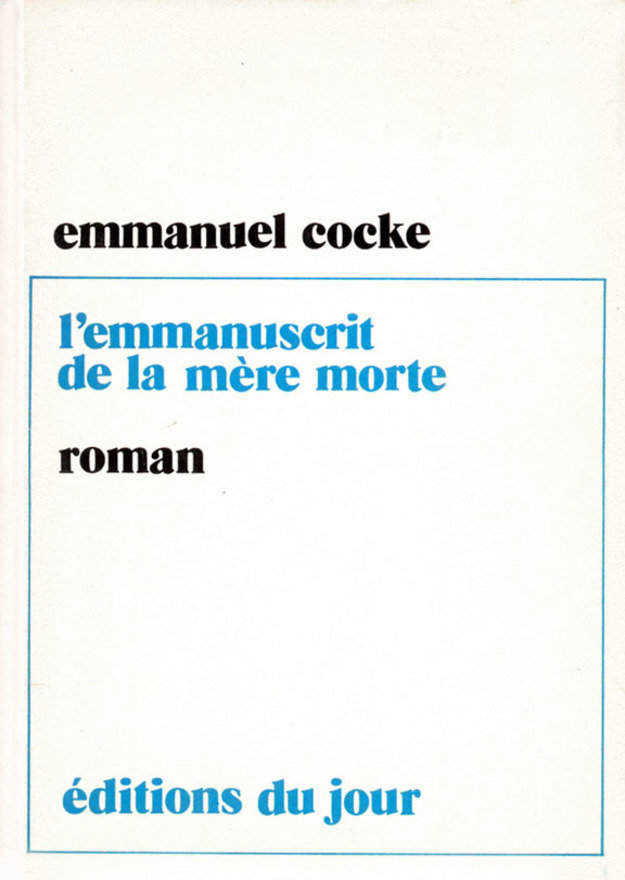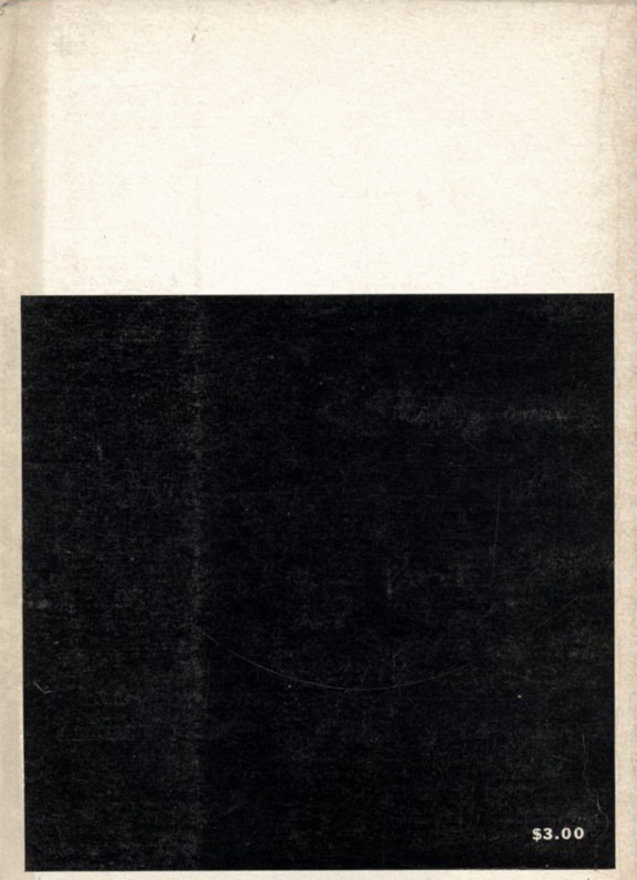À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
Alcoolique, drogué et dépersonnalisé (« avouer mon nom ne me servirait pas à grand-chose, car mon vrai nom est assez inspide »), il vient de laisser sa femme et perd graduellement la confiance de son fils, qui est de plus en plus découragé d’essayer de ramener sur le droit chemin un père qui « travaill[e] pour boire, et […] boi[t] pour [s]e tuer ». Décidé à se réinventer, à créer autour de lui une légende à la hauteur de celle de James Dean ou de Cendrillon, il devient assez rapidement Dieuble, un amalgame de Dieu et de Diable, qui aura pour objectif de créer un monde à son image.
Dans cette optique, il rédige un scénario qui deviendra à la fois la clé de son succès et sa propre histoire ; le film sera ainsi celui de sa légende, et sa légende n’existera que grâce à cet unique film, long métrage empruntant pour le cinéma le concept aujourd’hui bien connu de la téléréalité. Pour réaliser le chef-d’œuvre dont tout le monde parle déjà, il fait appel à Frank Meyer et à Philip Zimmerman, qui contrôleront tout pour que Dieuble n’ait pas à le faire lui-même, de même qu’à un « caméranain » dont les angoisses participeront de manière importante à la trame narrative. À travers tout cela, une multitude de muses feront leur apparition pour permettre à Dieuble de vivre la vie sexuelle éclatée qui revient de droit à une vedette de son calibre, mais plus particulièrement Christine Tremblay, dite la Virago, qui, seule capable de le confronter intellectuellement, le suivra du début à la fin de sa quête pour la gloire.
Si son projet fonctionne bien et qu’il parvient à s’imposer au monde, ce sera pourtant de courte durée : on le trouvera au moins aussi misérable qu’au début, le succès étant parvenu à le ruiner autant que ses échecs initiaux.
Autres parutions
Commentaires
1947 est l’année où la mère d’Emmanuel Cocke s’est suicidée, alors qu’il avait deux ans. 1947 est aussi l’année où, dans des grottes du Proche-Orient, on a découvert les premiers exemplaires de ce qu’on appellera les « manuscrits de la mer Morte », des documents rédigés entre le IIIe siècle av. J.-C. et le Ier siècle ap. J.-C., dont plusieurs consistaient en les plus vieilles versions de livres de l’Ancien Testament découvertes à ce jour. On comprend qu’Emmanuel Cocke, friand de jeux de mots et d’autoréférentialité, n’ait pas su résister à une si belle occasion de titre, bien qu’au-delà des noms des chats du personnage principal, qui renvoient aux quatre Grands Prophètes (Isaïe, Ézéchiel, Jérémie et Daniel), les références à la découverte historique soient peu explicites.
Néanmoins, comme l’Ancien Testament, c’est la genèse et les frasques du Créateur que raconte L’Emmanuscrit de la mère morte, un Créateur qui s’appelle cette fois non pas Dieu mais Dieuble, et qui est une projection de Cocke en maître du monde. Au moins aussi mégalomane que Yhwh et le Diable mis en commun, mais bien ancré dans un monde futuriste, Dieuble, entre les ébats torrides, les meurtres gratuits et les séjours dans l’espace, s’adonne à la création d’un film sur sa vie, qui sera le meilleur film de tous les temps, au point qu’une fois le travail terminé, « le chef-monteur [s’est suicidé] tellement il avait trouvé ça bon ».
Mais au contraire de l’Ancien Testament pour la gloire de Yhwh, et sans doute justement afin d’évoquer la pente symétrique qui s’érige entre Dieu et le Diable, le roman ne présente pas le triomphe de Dieuble comme éternel et inaltérable : après son ascension vers les sommets, le Tout-Puissant sombre dans une parfaite déchéance et apparaît déjà comme un has been, vieux, mêlé, ravagé, quand le film crève les écrans de l’univers. On comprend que le film en cours était l’unique projet de cette existence mégalomane, qui se termine en même temps que le tournage.
Bien que le roman flirte avec les délires de William Burroughs et le surréalisme d’un Raymond Roussel ou d’un Boris Vian, pour Emmanuel Cocke, l’écriture n’élude jamais l’autoréférentialité, et ce roman où il s’incarne en Dieuble n’y fait pas exception. En témoignent les derniers mots de son « introduction à trois inconnues », qui enchaîne deux citations : « “[P]sychodrame : représentation théâtrale thérapeutique où le patient joue lui-même un rôle approprié à sa situation (Le Petit Robert)” » et « “[I]l est, vous le savez, certains auteurs qui ne peuvent inventer sans s’identifier aux personnages de leur imagination” (Gérard de Nerval – Les Filles du Feu) ».
Cette présentation de l’œuvre, qui s’inscrit dans un « Pré-texte pour saluer Gauvreau » – dont un poème adressé à Cocke et destiné à inspirer le roman à venir tient lieu de préface –, ne fait que confirmer ce que le lecteur aurait pressenti à la lecture de l’œuvre, soit que la mégalomanie de Dieuble est aussi celle qui habite l’auteur. Si l’œuvre est originale, voire avant-gardiste dans le paysage littéraire québécois de l’époque, il est difficile de ne pas avoir par moments l’impression d’une certaine complaisance à la lecture d’une longue suite de fantasmes de sexe, de gloire et de violence, qui s’explique sans doute en partie par le contexte de publication.
Né en France et tôt initié à la nourriture intellectuelle par un père professeur de philosophie – avec lequel il entretient principalement une relation par correspondance –, Cocke arrive au Québec à l’âge de vingt ans, après un séjour en Israël, fort d’une culture littéraire française et internationale qui détonne dans un microcosme qui vient tout juste d’être bouleversé par la langue de Michel Tremblay. De fait, on sent que L’Emmanuscrit de la mère morte n’a pas pu bénéficier d’une direction littéraire qui lui aurait permis d’atteindre son plein potentiel. On ne peut réprimer, en le lisant, l’impression qu’il s’agit d’un pastiche oscillant entre le surréalisme européen et la contre-culture américaine, avec un rythme évoquant la chronique de Céline, que Cocke revendique d’ailleurs en fin de parcours (à travers une première phrase qui laisse voir la trace de Vian !) :
Alors que trois points noirs céliniens… s’éjectent de son nez, le Destin jongle avec la concordance des temps, martyrisant les vieilles barbes pointilleuses de l’arrière-garde de la littérature francophone qui jouent à “je-te-tiens-par-la-barbichette…”, des enfants se font défoncer les illusions quelque part vers le jaune, des inconnus écrivent des mots inconnus dans des chambres inconnues sur du papier volé, mots qui finiront dans les poubelles de l’humanité… des hommes mouchent leurs putains de femmes dans du dollar-kleenex […], des suicides se trompent de propriétaires, le monde tourne à l’envers avec une odeur de lait homosexualisé, des nains s’agitent pour rien, et les oiseaux vont mourir au néon. (p. 228)
On a l’impression que Cocke est constamment dans l’emprunt, qu’il n’a pas encore trouvé son ton, peut-être en raison d’un accueil trop chaleureux parmi les chantres de la contre-culture québécoise (Gauvreau en tête) alors qu’il était encore un très jeune auteur. La complaisance qu’on décèle est aussi sans doute due au fait que, comme trop d’œuvres à saveur surréaliste, L’Emmanuscrit… aurait gagné à être réduit du tiers, sans quoi il répète, reformule, tourne en rond. Encore une fois, ce problème aurait pu être résolu par une meilleure direction littéraire, qui aurait jeté un regard neuf et objectif sur l’œuvre afin de séparer le bon grain de l’ivraie.
Malgré ces quelques griefs, le roman de Cocke n’est pas sans qualités, ce qui justifie d’ailleurs que les éditions Tête première aient décidé en 2014 de le rééditer, en duo avec Va voir au ciel si j’y suis (premier roman de l’auteur, paru en 1971) et en même temps qu’une biographie de l’auteur signée par Ralph Elawani. La langue y est travaillée et les images sont évocatrices : le néologisme « filmécrire » – qui n’est pas sans évoquer la posture célinienne de « témoin » – apparaît d’ailleurs à plusieurs moments dans le livre et témoigne bien de la méthode créatrice de Cocke, qui était d’abord réalisateur.
Il s’agit d’un auteur dont il aurait fallu surveiller l’évolution, mais la lame de fond qui l’a emporté alors qu’il nageait dans le golfe du Bengale, à l’âge de vingt-huit ans, nous en aura malheureusement privés. [CaJ]
Références
- Bélanger, Reine, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. 286-287.