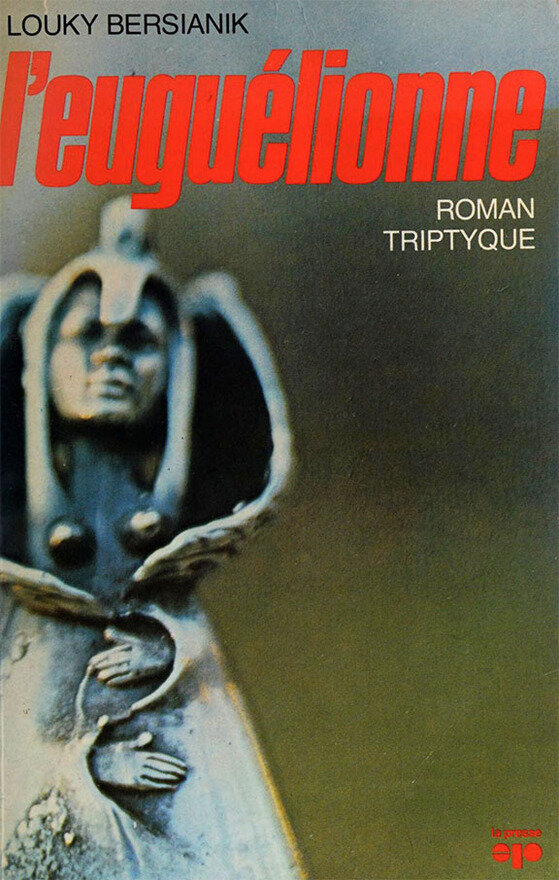Résumé/Sommaire
Dans la première partie du triptyque, « Nulle n’est prophète sur sa planète », une survenante extraterrestre visite la Terre, en provenance de la planète de Scramville où il existe des Législateurs, uniquement des mâles, qui ont asservi les femelles de l’espèce des Pédaleurs afin qu’elles engendrent d’autres Législateurs. Si elle se nomme elle-même l’Euguélionne, elle est une Pédaleuse à la recherche d’un mâle de son espèce. Dotée de pouvoirs transcendants, elle ne craint guère les humains de la Terre. Elle raconte les mythes de sa planète au sujet de la Terre et les Terriens ne tardent pas à la mythifier. Ainsi affublée d’une généalogie divine, elle passe pour celle qui « annoncera la bonne nouvelle de la fin d’un certain esclavage ».
Dans la seconde partie, « Les paramécies massacrées », l’Euguélionne retrouve une jeune femme de la Terre, Exil, qui assistait à une conférence de presse accordée par la survenante. Exil lui raconte l’origine du cri des paramécies massacrées qui marchent vers l’Homme, sous la forme d’un conte où une paramécie prit l’initiative de distribuer des bâtons à la moitié de la population originelle afin de s’emparer de force des cerveaux de l’autre moitié. Exil présente l’Euguélionne à ses proches et à ses amis, ce qui permet à la visiteuse d’être témoin d’une série de scènes de la vie quotidienne sur Terre. Des femmes appelées Omicronne, Epsilonne, Gamma, Hyota, Sigma, Lambda, Dzéta, Deltanu, Alik, Étéa, Gloria, Oksito ou Alyssonirik se mesurent à des hommes baptisés Upsilong, Xi, Alfred Oméga, le Docteur Phipsi, Tau, Tournesol, Onirisnik, Piro, Mosca, Bétamu, Microbeth, Dominik, Kappa, Migmaki, Écho, Argus ou Pékisse, dans tous les rapports possibles entre femmes et hommes dans une société occidentale de cette époque. Les deux nouvelles amies assistent à une pièce qui fait le bilan de la condition féminine, « Les Coquefredouilles », et à la performance d’une chansonnière. L’Euguélionne convainc Omicronne de quitter son mari et il se constitue autour d’Exil et de l’extraterrestre une grande famille liée non par les contraintes sociales mais par une affection et des affinités véritables.
Dans la troisième partie, « Transgresser, c’est progresser », l’Euguélionne s’enferme dans un entrepôt de mots afin de finir d’en apprendre le plus possible sur les Hommes de la Terre. Après avoir accumulé les expériences, elle souhaite éprouver les réflexions des auteurs. Quand elle ressort de la Bibliothèque nationale, c’est pour se rendre sur le mont Royal où St Siegfried livre un sermon sur la montagne. Quand elle prend la parole, l’Euguélionne se lance dans une longue dénonciation de la domination masculine – et aussi de la résignation féminine. Exil prend le relais en articulant un manifeste non pas de la féminité, mais de la gynilité.
L’Euguélionne lui fait écho avec un credo égalitaire et jouissif. Néanmoins, la société terrienne lui paraît si négative qu’elle décide de quitter la planète, non sans avoir essuyé le feu d’un peloton d’exécution pour incitation à la désobéissance civile, ce dont elle ressuscite. Le roman se termine sur l’insurrection des femmes croisées dans la deuxième partie qui, avec l’aide des hommes de leur espèce, vont briser les tables de la loi.
Autres parutions
Commentaires
Née en 1930, Bersianik est une militante aguerrie au moment où elle fait paraître cet ouvrage aussi singulier que monumental. Si l’Euguélionne est une visiteuse extraterrestre, son histoire est moins axée sur les péripéties de sa visite que sur sa découverte de l’oppression des femmes de la Terre et sur sa condamnation de leur condition.
Le nom de l’Euguélionne est emprunté au terme grec à l’origine du mot « évangile » et signifie donc « bonne nouvelle » (ou le bon, l’heureux message). En 1985, Bersianik indiquera qu’elle voulait d’ailleurs faire de son personnage une espèce d’anti-messie porteuse d’un anti-message. Le personnage même de l’Euguélionne est emprunté à un roman inédit, Le Squonk, rédigé en 1972. Le roman L’Euguélionne, lui, est bouclé en 1972-1974.
L’autrice numérote les éléments du roman comme des versets ou des sourates. Il est possible de discerner des correspondances entre la structure de l’ouvrage et l’histoire de Jésus. L’arrivée sur Terre de l’Euguélionne est un faux départ comparable à la nativité, à l’adoration des mages et aux premiers enseignements de Jésus au Temple. L’intermède de la vie ordinaire rappelle l’existence anonyme de Jésus à Nazareth et la troisième partie évoque le début de la mission messianique après une retraite au désert. La tentative d’exécution reflète la crucifixion, avant la montée au ciel de l’Euguélionne, devenue un personnage christique par excellence, la protagoniste du nouvel évangile de la Femme-Espèce.
En revanche, les épisodes de la vie quotidienne sont si plats qu’ils font soupçonner un roman à clé. La force du livre tient plutôt à ses contes et paraboles, à ses listes et litanies, à ses bons mots et traits d’esprit, voire à sa démolition en règle des grandes écoles contemporaines de la psychologie. Le freudianisme en particulier est un repoussoir exécré, qui inspire les analyses les plus caustiques de l’Euguélionne, qui en vient à proposer par symétrie inversée une idéalisation du trou.
Roman très charnel, L’Euguélionne aborde la sexualité avec franchise et enthousiasme. S’il y avait le moindre doute que le clitoris n’a pas été découvert par la génération actuelle, ce livre suffirait à le démontrer, même si le roman se montre plus ouvert sur les modes de la jouissance féminine que sur la féminisation des mots.
Enfin, la question se pose : faut-il parler de science-fiction quand la nature extraterrestre de l’Euguélionne est si clairement un prétexte pour traiter de l’inégalité des sexes ? La description des mondes extraterrestres tient avant tout de l’allégorie, sans aucun souci de vraisemblance. Pourtant, il est possible de soutenir qu’il s’agit d’un des ouvrages les plus marquants de la décennie dans la catégorie de l’utopie.
En effet, la dénonciation appuyée de la suprématie masculine dessine une utopie en creux. « L’alliance de la femelle humaine et du mâle humain, avec le partage des pouvoirs, serait quelque chose de tellement nouveau dans votre monde, qu’elle serait bien capable de le transformer » (p. 299) pour en faire quelque chose de neuf, prédit l’Euguélionne. Si cette dernière offre quelques aperçus d’une société plus égalitaire, l’utopie émerge surtout de la critique prolongée de l’étouffement des aspirations féminines (ou gyniles).
Certes, à force d’insister sur ce qui distingue la femme de l’homme, Bersianik en fait une antagoniste qui risque de ne plus rien avoir de commun avec le pôle opposé. L’aboutissement logique de cette opposition surgirait alors dans un roman comme Le Silence des femmes (2014) de Thérèse Lamartine, qui cite L’Euguélionne en exergue et qui imagine le massacre de presque tous les hommes de la Terre par les femmes pour créer un monde meilleur.
Le roman de Bersianik reste toutefois beaucoup plus positif. Malgré l’injustice et la répression, il se termine sur l’espoir d’un avenir plus rieur et fraternel. [JLT]
Références
- Belle-Isle, Francine, Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec VI, p. 306-309.
- Longtin-Martel, Nicolas et Ravary-Pilon, Julie, Atlas littéraire du Québec, Montréal, Fides, 2020, p. 301-302.
- Vanina, Suzanne, Magie rouge 21-22, p. 62-63.