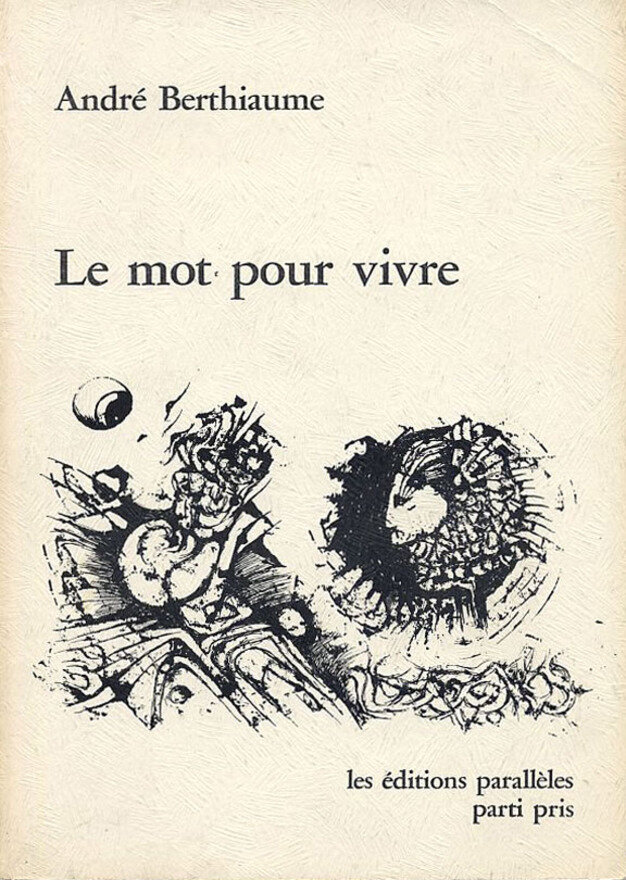À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
[4 FA ; 1 SF ; 18 HG]
Crépuscule
Le Rétroviseur
La Piétaille
Frasques
La Clause
L'Île
La Rue
Le Rire dans la neige
La Vérité
La Montée
Désarroi
Fragments
La Malbaie
Écrire
Le Bruit
Cauchemar rose
Transport en commun
La Poésie
Le Système
Aérogrammes
L'Adam II
Le Parc
Ménage à trois
Commentaires
Il est parfois utile de relire certaines œuvres car notre conception du fantastique et de la science-fiction peut évoluer avec le temps. En 1985, quand j’ai lu Le Mot pour vivre, j’ai classé six textes dans le corpus fantastique et un en science-fiction. À l’heure de ma relecture, il y a deux nouvelles que je retire du corpus fantastique, « Cauchemar rose » et « La Malbaie ». Réglons rapidement le cas de la première puisqu’il s’agit d’un rêve – ou d’un cauchemar, comme le précise le titre – tel que l’indique le narrateur à la toute fin : « […] je me réveille en sursaut ».
Le cas de « La Malbaie » est beaucoup plus intéressant et complexe en raison de l’indécision dans laquelle se trouve le lecteur à la fin. La première partie, quoique légèrement étrange et décalée, emprunte le registre réaliste et se conclut par « (je) m’assoupis en ruminant des banalités ». Dès lors, la deuxième partie relève-t-elle du domaine du rêve ou de la réalité ? Il s’agit là d’un bel exemple de deux lectures possibles, l’une réaliste, l’autre fantastique – le narrateur est-il réellement à bord d’un wagon dont les portes de sortie sont bloquées, est-il vraiment emporté par un train lancé à toute allure et qui a omis l’arrêt prévu à La Malbaie ? Pour cette raison, le texte est relégué dans la section Le milieu des franges.
Les nouvelles qui relèvent des genres de l’imaginaire composent la portion congrue du recueil. « Frasques », courte vignette humoristique sur l’escapade folle d’un pneu rechapé, semble miser essentiellement sur la ressemblance entre « rechapé » et « échappé ». « Le Rétroviseur » utilise le fantastique pour illustrer à quel point les embouteillages constituent une perte de temps. Le règne de l’automobile est également décrié avec une bonne dose de cynisme dans « La Piétaille », les piétons devenant des indésirables que les automobilistes se font une joie de traquer et d’écraser.
« La Vérité » est la classique histoire d’un homme qui pénètre dans un monde qui lui répugne un peu – un parc de manèges – et qui demeure prisonnier de cet univers dont il n’arrive pas à décoder les règles. Enfin, « Le Parc » s’inscrit dans l’un des thèmes majeurs du recueil en proposant une réflexion sur le pouvoir de l’écrivain et, surtout, sur le caractère vital de l’écriture.
Pourquoi, d’ailleurs, André Berthiaume écrit-il ? « Et je me rends compte ce soir que j’écris parce que je ne tiens pas tellement à mourir. […] Si j’élève aujourd’hui ce barrage de mots tremblotants chevrotants, c’est pour éloigner la fosse qui, un jour, m’accueillera jalousement. Écrivons, parlons pour en quelque sorte mourir debout. » (p. 122) Et plus loin : « Je demande à l’écriture une réponse – sans pouvoir très bien formuler la question. Je lui demande une certaine dignité, celle qui s’aperçoit tout de suite sur le visage, une certaine façon de vivre. » (p. 138) On a là toute la signification du titre du recueil : le mot pour vivre. Berthiaume croit beaucoup en l’écriture, il croit même qu’elle est essentielle pour vivre. Mais la tâche n’est pas facile. « Plus j’avance dans ce travail artisanal et un peu dérisoire de polissage, plus l’émotion originelle s’en va battant en retraite devant la grammaire. La littérature fait vaciller dangereusement la petite flamme d’hier. » (p. 123)
On voit donc qu’il y a dans Le Mot pour vivre une bonne dose de réflexions personnelles qui donnent aux nouvelles l’aspect d’un journal intime. En effet, Berthiaume ne fait pas que s’interroger sur ce qui le pousse à écrire, sur son art narratif en général ; il évoque aussi sa jeunesse en plein régime duplessiste, ses années de collège. Les vingt-trois nouvelles qui composent le recueil ne sont pas toutes autobiographiques, ouvertement ou non, mais elles brossent le portrait d’un intellectuel auquel Berthiaume pourrait certainement s’identifier.
Le Mot pour vivre présente toutefois des différences par rapport à Incidents de frontière qui lui a valu le prix Adrienne-Choquette en 1984 et le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois en 1985. Dans Incidents de frontière, l’auteur apparaît plus serein et la nostalgie afflue. Il se remémore certains épisodes de son enfance à Montréal. Est-ce l’âge qui l’amène ainsi à s’attendrir ? En tout cas, le recueil se situe plutôt du côté cœur tandis que Le Mot pour vivre se rangerait davantage du côté tête. L’écrivain se montre en effet plus critique face à la réalité sociale qui l’entoure en plaçant ses personnages dans des lieux qui suscitent le malaise, sinon l’angoisse. Il dénonce le climat étouffant qui régnait pendant que Duplessis tenait le Québec sous le boisseau. Le ton ironique rappelle celui de Jean-Paul Fillion dans ses récits autobiographiques. On y découvre un aspect caché de la personnalité de l’auteur, son côté mordant et acidulé qui s’exprime parfois par des formules lapidaires. « T’es un intellectuel qui avait vingt-cinq ans quand Duplessis est mort et qui a flirté avec le séminaire au lieu d’aller au bordel. » (p. 77)
Berthiaume a aussi cette belle faculté de se regarder à distance et de se moquer de lui-même quand il le faut. Dans « Fragments », il nous dépeint le cheminement d’un intellectuel écartelé entre deux générations. Il en fait le constat avec humour, avec un rien de désenchantement qui ajoute au propos une belle gravité. En moins de vingt pages, il résume avec beaucoup de justesse l’évolution du Québec sur une période de trente ans, du Refus global à la fin des années 1970. Comme texte branché socialement, il ne se fait pas mieux. Berthiaume laisse aussi entrevoir une veine satirique et moraliste qui évoque le Félix Leclerc du Calepin d’un flâneur dans « Le Système ». « Vous avez de l’argent à investir ? Devenez actionnaire d’une fesse ou d’un sein. Le cinéma porno, c’est actuellement le placement le plus sûr. » (p. 134) On regrette qu’il n’ait pas développé davantage cette veine. Le Québec possède peu de grands moralistes de la trempe d’Albert Brie, de Claude Baillargeon, de Félix Leclerc et de Jacques Godbout.
Dans « La Clause », Berthiaume tourne en dérision le comportement des humains qui ont besoin de normes, de règles pour fonctionner. Dès que l’une d’elles est abolie – la morale sexuelle ici –, toutes les licences sont permises et c’est l’anarchie. L’auteur n’est pas très loin de la manière dont Gaétan Brulotte décrit avec cynisme, dans Le Surveillant, l’application absurde des règlements et des lois qui régissent la vie quotidienne de l’individu.
André Berthiaume n’est pas homme à s’enfermer dans un style. C’est pourquoi il a choisi la nouvelle qui lui permet une très grande souplesse. Il peut ainsi passer d’un registre à l’autre, du réalisme le plus quotidien au fantastique en passant par l’introspection existentielle. Il peut jouer aussi avec la forme comme dans la dernière nouvelle, « Ménage à trois ». Il y relate trois fois les mêmes événements, mais sous une forme différente : 1° sous la forme d’un scénario ; 2° sous la forme d’une pièce de théâtre alors que tout est contenu dans le dialogue ; 3° sous la forme d’un journal personnel.
Dans cette nouvelle qui pourrait passer pour un exercice de style, il démontre en fait que chaque forme possède son langage propre et que chacune interprète différemment la réalité. Il s’agit toujours de la même réalité, mais vue sous un angle différent. Il n’est pas étonnant d’ailleurs que le personnage masculin de cette fiction soit Orson Welles, dont l’un des films a justement pour titre Vérité et mensonges. Ce cinéaste américain de génie, reconnu pour ses talents de mystificateur, incarne parfaitement ce vers quoi Berthiaume tend : ne plus être en mesure de distinguer, grâce à la magie de l’écriture, le vrai du faux, la réalité de la fiction.
Textes extrêmement concis qui expriment une émotion, récits plus longs qui veulent faire le bilan d’une existence, textes dévastateurs parce que tranchants comme un couperet ou attendrissants par leur sensibilité à la solitude humaine et à la vulnérabilité des êtres (je pense ici à l’excellent « Désarroi »), fragments de journal intime, récits de cauchemars urbains ou existentiels, réflexions sur l’écriture, Le Mot pour vivre contient tout cela. Hétéroclite, ce recueil ? Oui, mais pas éparpillé. On sent qu’il y a derrière cette apparente disparité un projet littéraire et une grande exigence.
Dans cette entreprise de dédoublement qu’est toute pratique d’écriture, l’auteur ne se complaît jamais dans le narcissisme même s’il y a tout lieu de croire que l’intellectuel qu’il dépeint, c’est lui en grande partie. C’est pourquoi on prend plaisir à la lecture de ce recueil, ouvert à différents tons et styles. Voilà l’œuvre d’un auteur caméléon. Elle ne cherche pas le scandale, elle ne vise pas l’effet spectaculaire ou la poudre aux yeux. Elle veut tout simplement rendre compte d’une émotion, d’un moment privilégié, d’un fragment de vie qui mérite d’être rappelé au souvenir par la force de l’écriture. [CJ]
Références
- Bélil, Michel, imagine… 11, p. 49-50.
- Parris, David, Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec VI, p. 551.