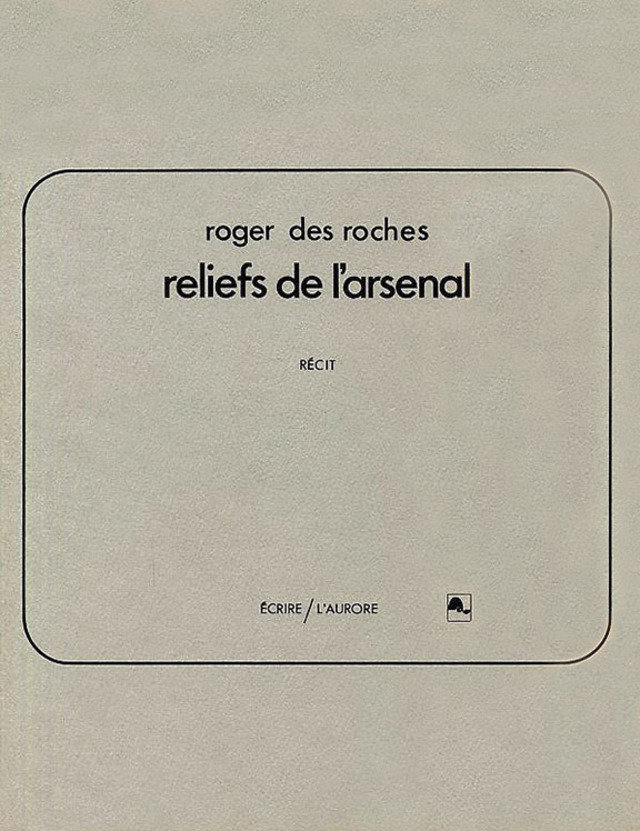À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
Il y a des initiales ou des pronoms personnels de personnages qui flottent dans des paragraphes tronqués, apparemment raboutés par le seul caprice typographique. On évoque dans le texte Ballard et Bradbury. Il y a un Rigélien à la peau bleue. Il y a quatre pages où un relatif suivi dans le texte évoque la science-fiction (p. 47 à 50), et où l’un des persos déclare : « Que ce soit l’exotisme habituel ou simple fantastique utilisé sciemment (donner sans l’être l’air d’un délire ?) pour plus amples corps étrangers, on laisse deviner le plus gros du décor. La planète sans qu’elle ne (sic) soit nommée, les instruments de destruction incroyables qui réduisent une page de texte serré en un seul déclic nerveux. » On dit ailleurs : « L’anticipation, la science-fiction, est un terrain suspect » et l’explication : la politique-fiction en particulier justifie des systèmes politiques en les transposant dans l’avenir.
Entre-temps, au travers, il y a une guerre, de quelqu’un contre quelqu’un, peut-être la Terre contre des Extraterrestres. Il y a des échappées peut-être érotiques. On parle d’un Arsenal, où ont peut-être lieu des recherches scientifiques sur la reproduction. Il y a visionnement de film, ou d’écrans. Il y a des rapports bizarres entre les personnages, dominants, dominés, on ne sait trop lesquels sont lesquels. Il y a un astronef. On ne sait comment cela finit. Mais cela n’a pas véritablement commencé.
Autres parutions
Commentaires
Bref, il faut lire ce texte littéralement stupéfiant – qui plonge dans une stupeur quelque peu hébétée – en se rappelant que Des Roches est avant tout un poète, un être de mots, et qu’il a vingt-quatre ans lorsque ce texte est publié sous l’égide de Victor-Lévy Beaulieu, dans une collection intitulée « Écrire ». C’est l’époque où la littérature de genres au Québec n’existe pas encore en tant que telle, et où elle est surtout une curiosité pour quelques jeunes et intrépides intellectuels québécois (comme en France une quinzaine d’années plus tôt) et surtout un prétexte à manifester un refus des règles et contraintes littéraires pétrifiées – le rabat de couverture l’indique bien : « Rien n’est ici concédé à la fiction traditionnelle – ni au lecteur ». Et c’est enfin une époque bien proche de la fin des années soixante et de la New Wave anglaise aux exigences et prétentions littéraires bien affirmées et dont le recueil-manifeste (ou presque) rassemblé par Harlan Ellison, Dangerous Visions, apparaît en syntagme semé à un détour de Reliefs de l’Arsenal.
Mais ce qui me frappe, moi, c’est à quel point ce texte aurait pu être écrit aujourd’hui et publié tel quel. C’est l’apanage de la poésie d’être ainsi, souvent, détachée du temps où elle est créée. Ou du moins, ce l’est d’un certain type de prose dont sont distendues au maximum les articulations logiques entre les phrases, effacés ou bouleversés les liens narratifs. On publierait ce texte aujourd’hui sous l’étiquette « postmoderne » : le refus des contraintes et exigences littéraires canonisées, l’emprunt ludique à des registres hétéroclites et hétérogènes – science-fiction, pornographie, poésie, français, anglais…
Devait-il être inclus dans L’ASFFQ ? Je crois que oui, dans la mesure où nous jetons un regard rétrospectif sur les débuts des genres identifiés comme tels au Québec (1974 est l’année où la revue Requiem commence à publier), et où nous en répertorions les prodromes aussi bien dans les revues, journaux et magazines que chez les éditeurs de livres. Il est fascinant de voir de quelle manière la modernité (à l’époque) donne la main à la soi-disant postmodernité au travers des années, comment des attributs de la science-fiction (et lesquels) ont été glissés en contrebande comme un signe de cette modernité dans la littérature non genrée des années soixante-dix, et comme la lecture peut en être différente, ou semblable, à quarante ans d’intervalle. [ÉV]
Références
- Chamberland, Roger, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. 189.
- Chassay, Jean-François, Spirale 64, p. 5.